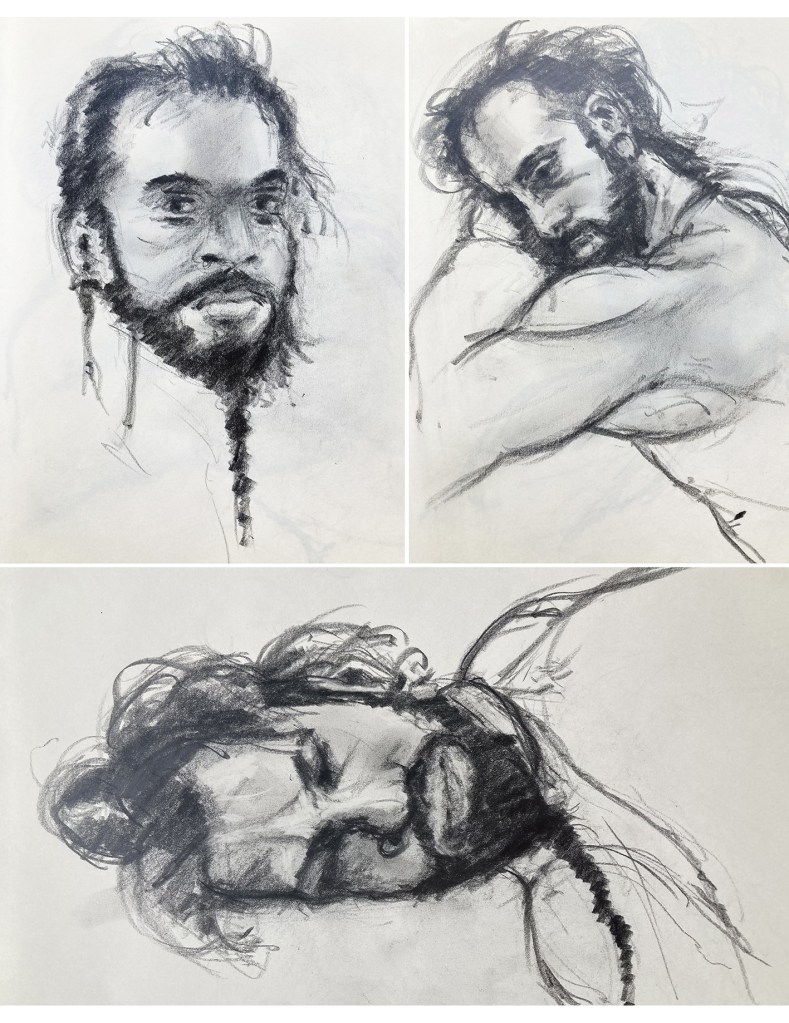Paul referme le livre, l’attrape par le dos et le secoue frénétiquement dans l’espoir absurde de retrouver la vieille dame sur le pont du bateau. Debussy. La mer. Tout ça. Il se reprend. Il respire. Il examine attentivement la couverture cartonnée, toujours aussi noire. Le titre, toujours écrit en blanc. Au-dessous, la même mention de l’autrice au nom imprononçable.
Le quatrième de couverture n’a pas changé.
Lucie n’a jamais pu accepter le monde en conserve, le soleil artificiel et la pluie à heure fixe. On n’efface pas les souvenirs, les romans d’aventure et les livres de géographie où tous les fleuves finissent par se jeter à la mer. On n’efface pas les bancs de brouillard, les soirs d’orage et les après-midi d’été.
Rien ne s’efface.
À quarante-deux ans, Lucie en a assez.
Cinq ans après le succès rencontré par «Mater», son premier roman, Malgorzata Viszekorek, nous transporte dans un univers fermé d’où quelques rares individus tentent de s’échapper.
L’histoire de la croisière lui avait donné des raisons d’espérer : le bateau, un dispositif idéal pour un vase clos. Bon, pas vraiment de rapport avec un soleil artificiel ou de la pluie à heure fixe, mais enfin on pouvait deviner l’amorce d’une relation entre le récit et cette courte introduction. Restait évidemment cet incipit bizarre, ce vieil homme qui parlait à son chat. Mais du fond de ses longues nuits de lecture, Paul avait toujours opposé une farouche résistance à l’envie de tourner une page sans l’avoir lue. Il avait ainsi parcouru des kilomètres de descriptions ennuyeuses, de dialogues creux et d’effets spéciaux syntaxiques destinés à transformer un simple paragraphe en un voyage initiatique. Souvent, il s’était endormi. Réveillé quelques instants plus tard, il cornait la page en maudissant par avance le moment où il faudrait reprendre la lecture du texte à l’endroit où ses yeux s’étaient refermés. Cette pensée lui gâchait par avance tout le plaisir de la soirée à venir.
Chapitre trois.
Page cinquante-neuf.
Le napalm n’a rien à faire ici. Qu’on me ramène sur le pont du bateau.