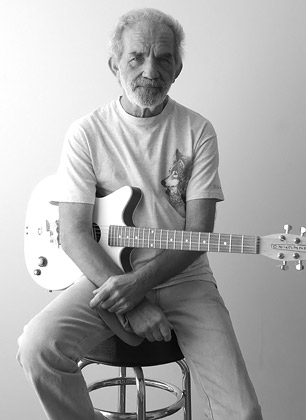A vélo sur les routes taillées dans le flanc des montagnes, le danger vient des étables.
Par extension, le danger vient de tous les espaces créés pour abriter ou contenir des têtes de bétail, laitières, comestibles ou purement décoratives si on est végétarien. Aussi vrai que la chèvre produit un lait épicé qui une fois transformé en fromage cabriole dans les rigoles bondissantes que trace le Beaujolais-Villages, la chèvre aime la vie en groupe, le partage et les échanges, le soir autour du feu de camp. Malheureusement pour elle, il arrive que la chèvre soit d’humeur folâtre, un rien l’amuse, un buisson, une fleur et la voilà qui s’égare, à l’instar de la brebis. Quelques minutes plus tard, elle se retrouve coincée au bord d’un gouffre sombre et vertigineux. Elle essaie de faire demi-tour mais le sentier est si étroit qu’elle sent le sol se dérober sous ses pas. Alors, elle se fige, les quatre pattes arc-boutées au-dessus du ravin. L’après-midi touche à sa fin. L’orage menace et la nuit va venir sans l’ombre de Monsieur Seguin.
Mais heureusement, dans chaque troupeau il y a un berger et dans chaque berger, il y a un chien, Rex, qui franchit en bondissant les obstacles, court, vole et ne venge personne si ce n’est l’honneur de la chèvre, honteuse d’être prise en si piteuse posture mais heureuse de pouvoir se tirer d’un si mauvais pas. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, Rex a fait le tour du problème, passé une corde autour du ventre de la chèvre, tiré à lui ce corps tremblant pour le déposer en sécurité sur une pierre plate et maintenant ils cheminent, lui devant elle derrière, ils sont en vue de la bergerie, la nuit se pose sur les montagnes et dans l’âtre rougeoyant fume une soupe de chalet.
Sa mission accomplie, Rex s’allonge sur le seuil de pierre. Vu de loin, on dirait qu’il somnole, la tête posée entre les pattes et la queue bien à plat sur le sol. Ne nous laissons pas leurrer par cette pose indolente. En vérité, le chien de berger ne dort jamais. Il veille. Il bande ses muscles au cas où entreraient dans son champ de vision un loup, un marcheur égaré ou une paire de pédales surmontées de mollets. Rex est un animal de course. Il dort huit heures par jour. Il ne boit pas. Il ne fume pas. Il suit un régime strict et exempt de matières grasses, alors que tout le pousse à mordre à pleines dents dans le tendre des hanches rebondies d’un marcheur potelé et rempli de hamburgers. Il visualise la texture de cette chair frémissante qui résiste à la douce pression de ses canines avant de céder, d’éclater en bouche, de libérer tous ses arômes de friture, de pain sucré et d’oignon mêlé à de la viande hachée. Mais voilà, à partir d’une certaine altitude et d’un certain niveau d’éloignement, le promeneur dodu s’efface derrière le sportif au mollet étique et bourré de protéines synthétiques, saveur orange ou faux chocolat! Pouâh! Le coureur compulsif, sec comme un coup de trique, rempli d’additifs et de substances chimiques qui attaquent l’émail et font des trous dans l’estomac. La première fois où Rex a goûté le jarret du sportif, il a eu un haut-le-cœur et il a vomi. Depuis, il a renoncé à la chair pâle des hommes. Le soir, allongé sur le seuil de sa bergerie, il recompte ses chèvres en rêvant à des poignées d’amour.
Alors, quand Rex me voit arriver, debout sur les pédales, à deux kilomètres à l’heure, enrobé à point, enveloppé mais ferme juste ce qu’il faut, les bas morceaux laqués par une fine pellicule de transpiration, quand il voit cette cible à peine mouvante et offerte à son regard concupiscent,
je vous raconte pas.
Sa gorge se serre et s’allonge. Ses yeux lui sortent des orbites. Il salive des rivières. Sa langue se déroule sur trois kilomètres. Il hallucine. Il a des vapeurs. La pression lui monte de l’intérieur. Le pelage se tend, se fissure, finit par craquer et sous les poils du chien surgit le fantôme du loup de Tex Avery.
Là, je compte mes abats et les watts qui me restent avant de finir en Royal Canin.
Il faut savoir que le chien de troupeau est une véritable machine à courir vite et longtemps. A la fois mélange de puissance et de vivacité, l’animal est d’un naturel obstiné et pas facile à semer. A vélo, deux stratégies : la première consiste en l’absorption massive de stéroïdes qui doubleront comme qui badine le volume de votre masse musculaire et vous permettront d’affronter la bête à mains nues. À noter toutefois que cette augmentation du volume carné risque d’entraver considérablement la fluidité de votre pédalage, ce qui pourrait s’avérer lourd de conséquences au cas où vous devriez avoir recours à la deuxième solution.
La deuxième solution, c’est la fuite. La fuite éperdue, debout sur les pédales et sans jamais se retourner, à condition de pouvoir rapidement se mettre dans le sens de la descente et d’avoir devant soi un beau chemin dégagé. J’estimerai la vitesse maximale du chien de berger à une pointe de 25 à 45 kilomètres à l’heure. À cette vitesse, sur un sentier de montagne, on mettra un frein sur la contemplation du paysage et on chantera Plus près de toi mon Dieu en mettant une majuscule à Dieu, dans le cas où on serait amené à se rencontrer très vite, que les présentations ne soient pas gâchées par des questions de protocole.
Donc je fuis à toute vapeur en sentant derrière moi le souffle chaud du carnivore incandescent à l’idée de me faire tomber de pour se repaître de mes chairs tendres et gorgées de sucres lents. Je l’entends qui halète, ses pattes frappent le sol, de plus en plus vite, de plus en plus près, il gagne du terrain, je le sens; ce foutu chemin est rempli de pierres, de trous, de bosses, que fait l’État, je vous le demande ? Au XXIème siècle, des routes en pierre alors que l’homme a conquis l’espace et tout recouvert de goudron.
Il est sur moi, je sens son haleine chaude, le bruit de sa respiration sous ma pédale gauche, le chemin fait un virage et moi, je ne me fais pas d’illusion : ce sera la cuisse ou le mollet. Mais non! C’est finalement sur mon talon que ses crocs se referment, sur mon talon, ah le con! Sa mâchoire se plante à l’arrière de ma chaussure, là où le fabricant, Dieu le bénisse, a prévu un gros renfort en caoutchouc. Alors, le temps qu’il réalise, je décroche mon pied de la pédale et de toutes mes forces, je lui balance ma chaussure en arrière dans sa gueule et lui surpris, il s’accroche. Je soulève ma jambe, il est moins lourd que je ne pensais, je le secoue de toutes mes forces, le virage part à gauche et c’est alors qu’il lâche. Derrière moi, je l’entends rouler, pousser un cri étranglé, j’espère qu’il s’est pris un arbre en plein dans sa face, un arbre ou alors l’entier d’un buisson de ronces qui l’a épilé de haut en bas, préparé pour le barbecue que je dresserais volontiers dans ce petit coin de montagne pour offrir sa chair rôtie aux oiseaux. L’enfoiré, la carne, l’engeance à quatre pattes. Sur mon vélo à tombeau ouvert, j’ai les mains moites et les jambes qui flageolent, je me retourne : plus personne derrière, plus personne devant, je relève la tête, juste à temps pour me mettre debout sur les freins.
Parce que devant moi, la route se termine en cul-de-sac.
J’ai passé plus d’une heure à patauger dans les pâturages, plus d’une heure à décrire un arc-de-cercle immense, à zigzaguer entre les trous creusés par les sabots des vaches, que les derniers orages avaient remplis d’eau saumâtre. Une heure entre les sapins accrochés à la pente. Une heure en portant mon vélo. Sur la pointe des pieds. Une heure à le guetter. Une heure sans respirer.
A vélo, sur les routes taillées aux flancs des montagnes, le danger vient des étables et de l’impulsion qui vous fait dire : « Tiens, ça à l’air joli, je vais voir où mène ce petit chemin. »