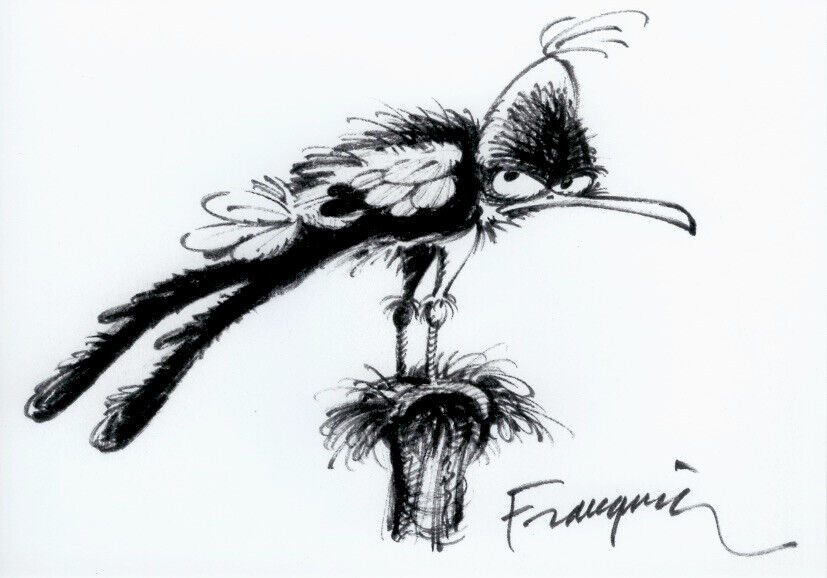Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les conneries que vous absorbez quotidiennement par les yeux et les oreilles vous abrutissent à petit feu ?
Je hais l’image littéraire à deux balles, la comparaison bien plantée sur ses deux pieds avec au milieu ce « comme » hideux et lourd comme du plomb. Qu’on me pardonne donc, mais sachez que vous n’êtes pas imperméables au flot continu de bêtise qui dégouline sur vous comme un crachin de fiente sorti d’un intestin engorgé.

Donc, voici une jumelle éloignée de Charlotte Gainsbourg qui se découpe sur un fond flou. Elle est jeune. Elle sourit dans le vague au sortir d’un repas frugal et équilibré. Le regard un peu vers le bas. Le menton en avant, volontaire, éclairé. Pas plus de trouble gastrique que de la personnalité. Capilairement calculée au bord du négligé. Tranquillement à l’aise. Zen, mais faut pas la lui raconter. Et calé dans la diagonale du regard, ce beau slogan pléonasmique jaune vert, bien contrasté pour les myopes et bien gras pour les mal-comprenants : au cas où on n’aurait pas saisi, la fausse Charlotte est sereine, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et qui c’est qui dit qu’elle est ? C’est la banque, que c’est elle qui créée de la sérénité.
Créer de la sérénité, comment ? Avec qui ? Une banque ? Stop !
Dans le flot de fiente mentionné plus haut, il arrive qu’un jet particulièrement malodorant vous retrousse les narines au point de réveiller vos sens euthanasiés. Vous pensiez sérénité et vous voyiez, mer, montagne, ciel, méditation, jardin japonais, Feng Shui et même ataraxie, cette paix de l’âme que tu atteins en évitant de partir en live pour tout et n’importe quoi.
Mais voilà qu’on t’apprend que la sérénité se créée, façon pièce montée ou pizza. Et qui possède la recette de la nouvelle Margherita ? Ta Banque, Charlotte ! Ta Banque. Alors, s’il te plait, arrête de faire des huit dans le sable avec ton râteau. Plus d’om et plus de yoga. S’il te plait, éteins ta bougie, tes bâtonnets d’encens et tes vagues souvenirs de philosophie. Moi, la sérénité, j’en vends au quintal. Suffit que tu me files ton pognon, je te l’emballe sous vide et je le dépose dans mon coffre blindé.
Oublie tous tes soucis, les mois sans fin, les maladies et la mort qui vient. Ta banque est là, simple et tranquille, elle créée aussi ton prochain lendemain.