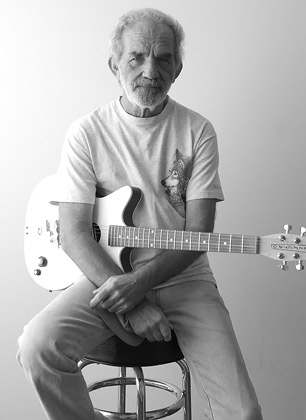On traverse le monde dans ses grandes largeurs, du Nord au Sud et d’Est en Ouest. En bateau, en voiture, à pied ou à vélo. Parfois il neige et parfois il pleut. Parfois on prie dans un avion, les mains moites, les fesses serrées au-dessus de dix kilomètres de vide pendant que les orages nous traversent à la vitesse du son. Parfois c’est la chambre à air qui éclate au milieu d’une forêt ou une petite boule remplie de liquide qui se déchire juste au-dessus du talon. Il faut s’arrêter. Poser une rustine sur le boyau crevé ou sur la peau à vif. Nous sommes tous de seconde main, réparés, notre peau criblée de rustines mal collées et nos corps rapiécés battent le tarmac usé du monde, pour aller voir ce qu’il y a de l’autre côté.
C’est souvent à l’heure du repas qu’on mesure le mieux la distance qui nous sépare de notre point de départ. Devant nous l’assiette parle une langue que nous ne comprenons pas : on peut bien mettre un nom sur les formes et sur les couleurs mais pour le reste, on reste perplexes, interdits; cette masse sombre et compacte sur la gauche ne ressemble à rien de connu. Il faudrait effectuer un prélèvement, l’envoyer au laboratoire, attendre le résultat des analyses. Il faudrait que quelqu’un goûte, voir ce qui se passe ensuite, si son visage se décompose, s’il tombe subitement de sa chaise en se tordant de douleur et en poussant des cris affreux. Il faudrait… Aller aux toilettes. Autour de nous les gens mangent et personne ne meurt, pour le moment. Alors, on prend son couteau, sa fourchette, ses baguettes, on porte à sa bouche un fragment minuscule de cette chose poreuse et noire. On ferme les yeux et on remet son âme à Dieu.
Rien de tout ça dans ce restaurant illuminé au néon, chaises en bois sombre et menu écrit à la craie sur le mur. Nous sommes ici en pays connu et italien. Devant moi, une assiette creuse, ils avaient écrit « lasagne » mais on dirait plutôt une soupe de pâtes larges et brillantes qui flottent dans un liquide vert trop profond. Je trouve ça plutôt olé olé, pour tout dire un peu tiré par les cheveux et cette extension excessive du concept lasagneux me fait penser que décidément tout se perd ma bonne dame, tout fout le camp. Non, ceci n’est pas une lasagne, et non, cher cameriere, vous pouvez garder ce fromage râpé et sûrement trop sec qui ne servira qu’à masquer le goût de l’imposture, je ne veux pas d’une infusion de pâtes au Parmesan.
Le serveur repart, il est temps de sacrifier l’agneau.
Avec le couteau, je découpe un petit bout de pâte, je le pique du bout de ma fourchette et dessus, je dépose un peu de cette sauce couleur potager printanier avec vue sur la forêt. Avant ma bouche, mon nez a juste le temps de me prévenir, de me dire que houlà, on dirait bien que ça va chier, pas le temps d’enregistrer, la pasta atterrit déjà sur ma langue et WHAM! Je suis littéralement arraché de ma chaise, emporté par le souffle vert et frais du basilic brouté à même le sol, quelque part dans un jardin exclusivement arrosé à l’essence de printemps et additionné de quelque chose qui ressemble à du Parmesan… Une seconde, il faut que je réfléchisse, mais mes sens en déroute ne m’envoient plus qu’un seul message : « Encore… Encore… Encore… » Je recharge la fourchette aux limites du tonnage maximal pour tester la chose à pleine puissance. Mon Dieu. Mon Dieu fragile et capricieux, bien sûr que j’ai des doutes, mais l’existence de cette pâte épaisse et tendre qui se rend entre mes dents sans jamais cesser d’être élastique, la texture de ce pesto et cette touche de Parmesan où je crois discerner une ombre de Pecorino, quelque chose d’un peu âcre et d’infiniment doux, cette explosion de soleil vert dans le creux de ma bouche prouve que même si Vous n’existez pas, Vous méritez d’être vénéré.
En face, de l’autre côté de la table, alarmée par mon silence, une personne aux yeux jaune-vert me demande si c’est bon. La bouche remplie d’un monde couleur basilic et la tête en déroute, je parviens juste à lever un pouce, à émettre un groumpf sonore pour signifier toute l’étendue de ma jubilation. Elle secoue la tête. Elle le sait, je suis consternant.
Je lui fais signe d’attendre, attendre que le voyage se termine, que je redescende, que je lui explique que lorsque Dieu s’en va, Il laisse dans Son sillage un léger parfum de fromage de brebis mélangé au pesto.