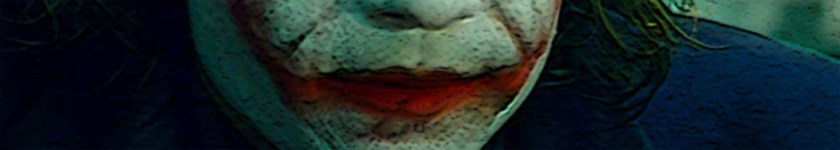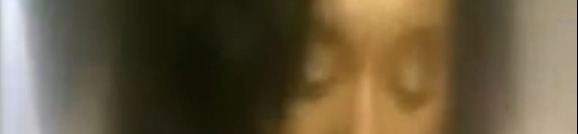Le 14 février 2003, Dominique de Villepin se trouve au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour parler d’une affaire compliquée.
Résumons.
Un jour, George Bush voit sur ses satellites des images en couleurs en provenance de Bagdad, Irak. Sur les photos, on distingue très clairement des fabriques de mayonnaise en pot. En zoomant à l’intérieur des pots, le président des États-Unis d’Amérique découvre horrifié la présence de crème fraîche 100% matière grasse et 2000 calories au centimètre carré, ou cube, c’est selon. En bout de chaine, une mention imprimée sur le haut des cartons d’emballage le glace d’effroi : » 0 calorie Deluxe Mayonnaise ». Et juste en dessous : « For US use only », seulement pour estomacs américains.
George Bush vient enfin de découvrir l’origine de l’épidémie d’obésité qui ravage son pays. Partout dans les hamburgers, la mayonnaise zéro calorie est peu à peu remplacée par de la bonne grosse crème fraiche. Une montagne de graisse. Une arme chimique de destruction massive. Le Mal Absolu.
Il n’y a plus une minute à perdre. Il faut détruire ces fabriques ennemies et le pays tout autour. Que la patrie en danger envoie sans délai ses enfants pour qu’ils versent un sang impur et rempli de mauvais cholestérol. Donc, les États-Unis briquent leurs porte-avions quand un blanc-bec fin de race au profil d’aristocrate dégénéré monte sur l’estrade des Nations Unies pour dire que non, il n’est pas prouvé que l’utilisation prolongée de crème fraiche 100% matière grasse soit à l’origine du désastre sanitaire qui est en passe de faire éclater les panses étatsuniennes.
Oh putain. Quand George Bush voit ce vieux beau débiter en Français médiéval ses doutes délicats de fiancée rétive, son sang ne fait qu’un tour. Il convoque les états généraux de la première puissance du monde dans le bunker pressurisé prévu à cet effet. Il y a là le Pentagone, la CIA et le FBI. George W est dans tous ses états. Enfin, c’est qui le maître du monde ici ? Qui c’est qui a envoyé l’homme dans la lune et inventé le Coca à la Cola ? La voiture qui fait vroum ? Et l’essence, hein, l’essence, le pétrole, qui a été inventé au Texas, le pétrole c’est du poulet ? Non, bien sûr. Le pétrole c’est pas du poulet. Et il faut que ces Français arrogants et illetrés comprennent une fois pour toutes ce qu’il en coûte de s’attaquer à l’Empire.
Là, ça devient un peu technique. Il faut savoir qu’en Amérique, les frites s’appellent « French fries », qu’on pourrait traduire par « frites françaises ». Il y a aussi le « French Kiss » connu chez nous sous l’appellation « rouler une pelle, ou alors une galoche ou une saucisse » mais nous nous éloignons du sujet.
Résumons.
Partout en Étatsunie, des établissements de restauration rapide font l’apologie des produits français. Mc Donalds et Burger King. Kentucky Fried Chicken et Taco Bell. Des traitres. Des collabos. De sournois agents de la propagande française. French fries par ici. French fries par là. French fries with MAYONNAISE! L’horreur absolue. Et c’est quoi la prochaine étape de l’invasion ? Un distributeur de Beaujolais à côté des fontaines à Coca ? Non, mes chers compatriotes. Nous résisterons jusqu’à notre dernier souffle face à l’arrogance de l’impérialisme français. À partir d’aujourd’hui, interdiction de mettre la langue dans le baiser. Embrassons-nous joyeusement. Embrassons-nous fougueusement mais surtout, embrassons-nous chastement. Par la toute-puissante autorité que Dieu – qu’il nous bénisse – m’a confiée, je décrète également la fin des French fries qui seront immédiatement remplacées par des Freedom fries, les frites de la liberté. FREEDOM. Parce que la liberté a été inventée par et pour le peuple américain. Et aussi parce que ça commence aussi par F et R. C’est plus facile, pour retenir.
Ainsi fut – à peu près – fait en l’an de grâce 2003. La guerre fut déclarée le 20 mars 2003, nom de code « Iraqi Freedom » parce que George Bush avait retenu le nom depuis l’affaire des frites. Le 1er mai George Bush, toujours lui déclarait que la guerre était terminée et que le nom de code pour célébrer la fin des hostilités, c’était « Mission Accomplished ». Mission accomplie et fin de la guerre en Irak.
C’était le 1er mai 2003.
God Bless America. Que Dieu nous protège de l’Amérique.
Deux liens qui résument cette histoire de frites (en Anglais) et de guerre qui dissiperont les soupçons qui pèsent sur la rigueur spartiate de ce blog toujours soucieux d’effectuer un vrai travail de fond sur tous les sujets importants.
Et surtout cette chanson de Robert Plant qui dépote et que je vous laisse écouter ici.