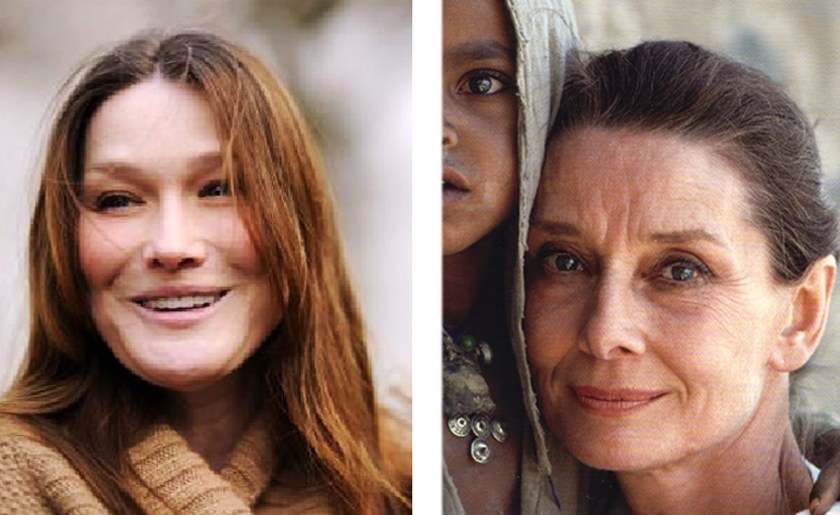« Mais qui sont donc ces sondés ? »
Je me souviens d’avoir lu cette phrase dans un roman de Françoise Sagan, je crois qu’il s’agit de La femme fardée où Edma Bautet-Lebrêche, femme d’Edmond Bautet-Lebrêche des sucres Bautet-Lebrêche pose cette question en découvrant un article dans le journal.
Il me semble qu’elle répète la question : « Mais qui sont donc ces sondés ? » Et qu’elle poursuit : « Qui sont donc ces sondés, on dirait un air de cha-cha-cha » Elle chantonne : « Qui sont donc ces sondés ? » C’est une jolie scène, on visualise très bien Edma, aristocrate en tailleur crème, sur le pont d’un paquebot de luxe baigné de lumière couleur caramel chaud. Edma impeccable et surannée, suspendue quelque part entre le foxtrot et la bossa nova. Je crois bien, mais je ne suis pas sûr.
Peut-être que ce n’était pas dans La femme fardée, mais plutôt dans Le garde du cœur, La chamade, Un peu de soleil dans l’eau froide ? Ou peut-être dans Le chien couchant ou De guerre lasse, je ne sais plus. Ce que je sais, c’est que Françoise Sagan avait le génie des titres. Un orage immobile est un très beau titre, un titre immobile qui vous fait voyager. Elle a aussi écrit un livre qui s’appelle Les merveilleux nuages, titre qu’elle a emprunté à Charles Baudelaire, Françoise Sagan était aussi une très grande lectrice.
C’est curieux, ce désir qu’on a de faire des catégories et de coller des étiquettes. Baudelaire, poète des Fleurs du Mal, qui va au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau, on comprend que Baudelaire ne rigolait pas avec la poésie, qu’il était prêt à se défoncer à la colle pour produire des vers que personne n’avait écrits avant lui. Baudelaire devient le poète défoncé. Camus devient L’Etranger. Il y a les auteurs qu’on étudie et ceux qu’on n’étudie pas. Les auteurs majeurs et les mineurs. Les auteurs populaires. Sur Françoise Sagan, on a collé l’étiquette « auteur-frivole ». Frivole, c’est à cause des casinos, des Aston-Martin qu’elle explose au soir ou au petit matin, je ne sais plus trop, là aussi ma mémoire défaille. Frivole à cause de Saint-Tropez, de l’argent et de la mer. Tout ça, c’est ce qui se voit, ce qui se met en page dans les journaux. Des éléments de biographie. Mais qu’est-ce que la biographie fait aussi la musique des mots ?
Françoise Sagan a été célèbre à la parution de son premier roman. Elle avait 19 ans. Elle a ensuite publié plus d’une vingtaine de romans et de nouvelles que tout le monde a achetés et que peu de gens ont lus. Partout, elle fume, elle boit, elle danse et la musique des boites de nuit assourdit la musique de ses mots.
Alors, Françoise Sagan, personne frivole, pourquoi pas. Personnage lunaire, assurément. Mais ça, c’est le personnage, justement. Il y a la personne, le personnage et après, il y a les mots, sa manière de tourner les phrases, son style, sa façon bien à elle de raconter les histoires. Si on oublie le personnage pour ne garder que les mots, on verra que sa langue tient mieux la route que ses Aston-Martin. Quand elle prend vraiment le temps d’écrire, elle apporte aux mots un soin classique et impeccable. Elle taille un chemin doux et fluide et parfois le texte fait un dérapage, un élégant tête à queue. Elle embraye, redonne un coup d’accélérateur et replace ses phrases dans le sens de la marche, une marche qui ressemble à une promenade baignée de soleil et de nuages pas si merveilleux.
Si on observe les personnages qui font vivre ses histoires, on découvre un regard triste qui voudrait être gai. Une manière de garder la nuque bien droite et le front haut, alors qu’il fait froid à Paris lorsque la fête est finie. Il est souvent cinq heures du matin, il pleut hallebardes et les taxis passent sans jamais s’arrêter. Les taxis passent et avec le temps, elle sait bien que l’histoire va mal se terminer. Mais elle y va quand même, un peu ébouriffée, un peu mal maquillée, elle y va quand même, un demi-sourire caché au coin des lèvres. Et même si, au fond d’elle-même elle est un peu morte de peur, elle tient le cap et le maintien.
La mort, elle veut bien, mais pas trop tôt le matin. Faire les choses dans l’ordre. D’abord passer à la salle de bains. Faire un brin de toilette. Avant tout, il faut de la tenue.
Alors, pour la mort, on est bien d’accord, mais la mort attendra la sortie du bain.
P.S. Je ne suis pas du tout sûr que la citation qui figure en titre se trouve dans La Femme fardée. À l’origine, je voulais juste parler des sondés dans les sondages. Ensuite, j’ai pensé à Françoise Sagan et me suis à écrire tout à fait autre chose. On mesure mieux ici l’état d’égarement dans lequel je me trouve. Tout ça est bien consternant.